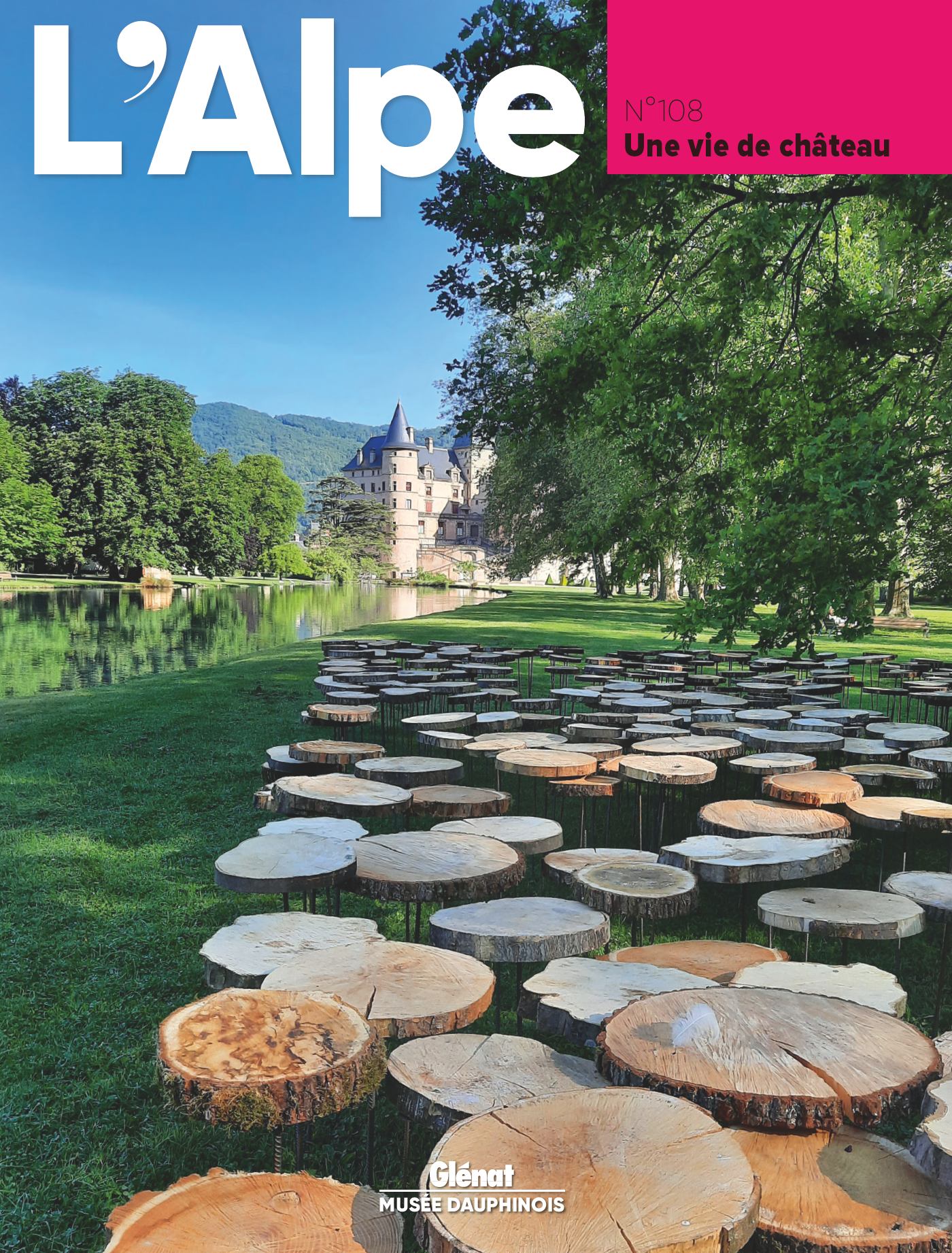Laurence Revey, chanteuse valaisanne, croise sommets suisses et Alpes d’ailleurs, instrumentations traditionnelles et audaces rythmiques, savoirs de l’ethnologue Bernard Crettaz et programmations musicales rares d’Hector Zazou. Fée des villes ou fée des champs ? Réponse en forme de portrait.
Par Pascal Kober, rédacteur en chef de L’Alpe.
Elle est entrée au Terminus, a salué à la cantonade quelques ami(e)s attablés de-ci de-là avant de jeter un regard circulaire sur la salle. Et de vous décocher un sourire large comme ça en lançant un « Je me réjouis ! » Puis, elle a commandé un cynorrhodon. Coutume, que de boire cette tisane d’un rouge ardent à Sierre, canton du Valais, confédération helvétique, à la presque frontière entre la Suisse romande et les cantons germanophones. Laurence Revey, chanteuse du monde, est ici sur ses terres.
Au fil de ses rencontres en Grande-Bretagne, en Islande ou en Norvège, elle a certes fait appel aux meilleurs musiciens internationaux pour peaufiner ses productions discographiques (Nils Pietter Molvaer, Bugge Wesseltoft et autres Hector Zazou, « ma quête nordique », dit-elle). Durant la dernière décennie, elle a bien écumé les scènes allemandes, françaises, italiennes et bientôt brésiliennes pour y distiller son chant alpin inouï. Mais elle est ici sur ses terres. Au cœur des Alpes.
Le titre de son dernier opus ne prête guère à confusion : Le cliot di tsèrafouin est la traduction en patois valaisan du « creux des fées », une vieille légende du cru qui conte l’aventure heureuse d’un montagnard tombé amoureux d’une fée. Banal disque folklorique ? Pas le moins du monde. Car si les Alpes sont bel et bien présentes dans le choix des mélodies et jusqu’au tréfonds des textes, la planète entière (et une planète plutôt urbaine) s’invite dans cette joyeuse alchimie harmonique. Alors, quoi ? Énième avatar d’une world music qui ne sait plus où donner de la tête ? Pas davantage. Nous sommes ici à mille lieues du métissage complaisant ou du naïf (quand il n’est pas prédateur…) collage de cultures.
D’où l’envie d’une rencontre. Qui peut bien se cacher derrière ce visage trop lisse apparaissant au détour d’une forêt profonde sur la pochette d’un disque ? D’où, aussi, l’étonnement quant à la tanière de la belle. On l’attend dans un restaurant branché à Genève, Londres ou Paris et elle, elle commande un cynorrhodon dans un bar en face de la gare de Sierre, Valais. On l’imagine vivre dans un chalet d’alpage en bois et elle, elle réside en appartement dans un petit bloc d’immeubles modernes d’une bourgade qui n’a rien d’alpin. Paradoxes ? Pas sûr. Plutôt des clés pour mieux pénétrer l’univers de la chanteuse.
Accoucheuse des âmes
Pour le citadin, Sierre, c’est le bout du monde. Pour l’amoureux de l’alpe, c’est le bonheur à quelques lacets de la station très huppée de Crans-Montana ou des charmes désuets du val d’Anniviers. À l’exacte distance, pour Laurence Revey, entre un monde qui bouge (parfois si vite) et une histoire qui ne doit surtout pas être un enracinement. Deux antipodes dont s’abreuve son art et qui transparaissent avec force dans son dernier disque. À l’échelle locale, Sierre, c’est encore le versant urbain d’une montagne rurale qui, même en Suisse, n’en finit pas d’agoniser. « Dans cette région paysanne, la notion d’art, sociologiquement parlant, ça se vit comme une passion, en dehors d’une activité normale. J’ai grandi en n’imaginant pas du tout qu’artiste pouvait être un métier. »
Dans le val d’Anniviers, habitait sa « grand’maman ». Une mamie qui regardait l’arrivée de l’électricité dans son village d’un œil dubitatif, qui a toujours refusé l’eau courante, qui parlait uniquement le patois valaisan et dont Laurence ne comprenait pas le mode de vie : « Je suis une enfant de la ville, gavée aux émissions de télévision, et je ne parle pas patois. Nous ne communiquions donc quasiment sur rien puisque nous n’avions pas les codes. Plus tard, je me suis rendue compte qu’il avait manqué une génération dans la transmission des racines. C’est ça qui m’a intriguée et qui m’a fait me pencher sur mon identité personnelle. »
Un choc qui, au fil des années, lui donnera l’envie d’aller voir ailleurs. Ce sera d’abord une initiation au théâtre, puis l’illumination de la première scène avec cet unique spot rouge qui vous mange le regard et plonge celui des spectateurs dans le noir absolu, le vertige des tréteaux, la vie qui va, qui pousse, la vie d’ici, puis d’autre part, de Paris, de l’Afrique, des Balkans ou de la Scandinavie : « J’ai alors abandonné tous mes projets de vie raisonnable. Je voulais être accoucheuse. Je suis devenue accoucheuse des âmes. C’est à peu près la même chose… »
Sierre, c’est enfin le versant cocon d’une urbanité qui, parfois, lui pèse. L’échappée belle qui permet de souffler, de relier les fils des liens familiaux et d’étancher cette soif des éléments. L’eau, la montagne, l’air, la forêt surtout, sans lesquels Laurence Revey ne serait pas la même. Et qui lui sont sources d’inspiration. Elle a peur de ses propres mots ? Le patois valaisan lui fera parure. Ni cache-sexe, ni nostalgie. Juste la certitude que là se niche « un langage qui m’est intime, une charge organique qui parle au ventre, dans une langue vivante pendant des siècles et qui n’est pas encore tout à fait morte ». Pudeur ? « Au départ, oui. À la montagnarde. Il y a des choses que l’on ne dit pas si facilement… »
Ne surtout pas respecter la tradition
Et puisque la chanteuse ne fait rien à moitié, elle ira jusqu’au bout de ses engagements artistiques, s’attachant la participation de patoisans notoires (le conteur Claudy des Briesses), de musiciens (Gabriel Yacoub, du groupe Malicorne) ou encore de scientifiques (Bernard Crettaz ou Isabelle Raboud) : « Tous m’ont encouragé à ne pas respecter la moindre idée de tradition. C’est une démarche créative et non ethnographique. J’ai ainsi trouvé, dans les montagnes, beaucoup de chansons de l’époque napoléonienne, des histoires de guerre dans les Balkans qui étaient probablement l’équivalent des séries américaines d’aujourd’hui. Mais ce n’est pas ce que je voulais. Je cherchais des stimulations. »
Qu’elle a trouvées. Et si le résultat de cette quête est si enthousiasmant sur le plan musical, c’est qu’à aucun moment, Laurence Revey n’a tenté de s’approprier cette tradition valaisanne séculaire. Elle l’a d’abord nourrie de ses expériences aux quatre coins du monde avant d’en proposer sa propre lecture, singulière et dérangeante : « Je n’ai pas fait un retour au pays. Ce disque, je l’ai composé à Paris. En grande partie dans le métro. Le travail nait systématiquement du mélange entre deux terres. Les grandes crises identitaires, par exemple chez les gens d’origine maghrébine, naissent aussi du fait qu’on a les pieds entre deux cultures. »
Le public ne s’y est pas trompé : plus de dix mille disques vendus sur la seule Suisse, essentiellement romande. Rapporté à la population française, un tel chiffre signerait un disque d’or (plus de cent mille exemplaires). Mais de ce côté-ci des Alpes, personne ne connaît Laurence Revey. Elle a fini son cynorrhodon, rouge, et a lancé un « À tout bientôt ». Ce bientôt, ce sera au Musée dauphinois, en duo, pour un « retour, avec les battements et le cri, à l’origine du son ». Nous, on se réjouit. Mais ça, c’est une autre histoire…
Pascal Kober
L’Alpe n° 22, hiver 2004